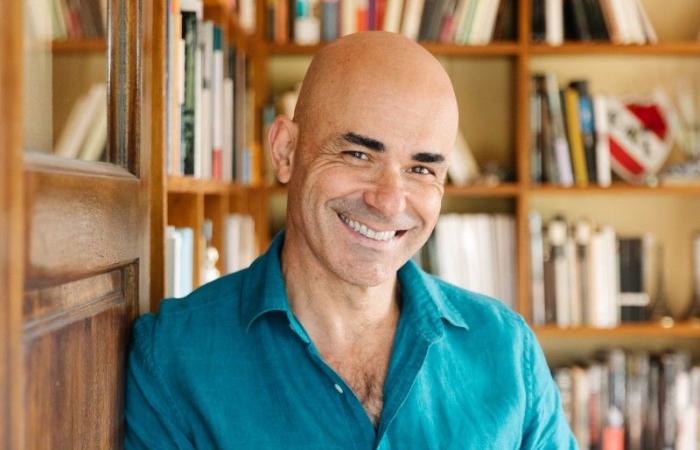
Paulo Menotti / Spécial pour El Ciudadano
« Mon projet initial, si une telle chose existait, était seulement d’écrire le premier des livres, intitulé « Les Jours de la Révolution ». Mais l’éditeur m’a proposé d’intérioriser le sujet, ou de l’étendre. Et bien sûr, par souci, j’ai réfléchi à la vision d’ensemble et j’ai pensé que la question pouvait être élargie à la formation de l’Argentine en tant qu’État-nation dans la perspective d’un long XIXe siècle, jusqu’en 1916. Comment l’Argentine s’est construite sur divers les niveaux. Cela, pensé à quatre livres », commence l’interview d’Eduardo Sacheri en faisant référence à son nouveau livre « Les jours de violence ». Une histoire de l’Argentine quand elle commençait à être l’Argentine (1820-1852)», qu’il a présenté aux libraires jeudi 13 dernier à Rosario. En dialogue avec Le citoyenl’écrivain, scénariste de cinéma, professeur d’histoire et historien a partagé quelques concepts qui caractérisent ce texte qui aborde une période conflictuelle et violente de l’histoire nationale, en plus de faire référence à son intérêt pour la diffusion de l’histoire, à son profil de narrateur et d’enseignant et. sa vision de l’histoire comme un processus de changement.
Des temps violents
« En référence au nom des livres intitulés « Les Jours de », il me fallait trouver un concept pour le second. J’étais entre deux idées. L’une était “le temps des provinces”, basée sur l’approche de José Carlos Chiaramonte, dans le sens où depuis 1820 il n’y a rien de semblable à un État central, ce qu’il y a, ce sont des provinces. L’autre était la « violence » parce qu’elle me donnait le sentiment que la militarisation révolutionnaire et le désastre économique donnaient au système politique de l’époque un primitivisme très violent et une grande exposition de cette violence. À cette époque, cela acquiert un caractère sémantique dans le sens où exercer la violence, la théâtraliser, devient un message. De manière à établir un lien politique d’une manière plus forte que lors de l’étape précédente et plus claire que lors de l’étape ultérieure », explique Sacheri en se basant sur le titre de son deuxième livre d’histoire. Le premier, « Les jours de la Révolution. Une histoire de l’Argentine quand ce n’était pas l’Argentine (1806-1820) », enquête sur la Révolution de Mai et la Guerre d’Indépendance, tandis que son deuxième volume aborde la période de dissolution des Provinces-Unies et du Rosisme.
Le fait est cependant que la violence n’a jamais cessé d’exister, même si l’auteur réfléchit aux raisons pour lesquelles il a choisi ce concept.
« Bien sûr, c’est une hypothèse, mais à partir de Caseros, la période suivante 1852-1880 continue d’être très violente ; Mais à mesure que l’État national émerge, j’ai le sentiment que cette violence tend à être régulée. Sans parler des années 1870, lorsque la justice commença à intervenir dans les rébellions, etc. “Il s’agit de la théâtralisation de ce qui est fait avec les morts”, dit Sacheri, donnant comme exemple l’exécution de Chacho Peñaloza, qui était sanguinaire mais qui, dans les années 1860, a attiré l’attention contrairement à l’exposition qu’ont reçue les frères Reinafé (accusés d’assassinat). Facundo Quiroga en 1835) lorsque leurs cadavres furent longtemps exposés dans le Fort de Buenos Aires. “Ou le massacre d’Oribe en 1841, 1842, en tournée à l’intérieur”, ajoute l’auteur.
Ni mitristes ni révisionnistes, ni bons ni mauvais
L’historiographie argentine est née des textes de Bartolomé Mitre avec ses histoires de Belgrano et de San Martín, d’où s’est forgée la soi-disant « histoire officielle » ou « mitrista » qui a placé certains personnages de notre passé comme des héros et les a condamnés à l’échec ou à la mort. place des méchants aux autres, en particulier aux dirigeants. Dans les années 1930, un « révisionnisme » a émergé, condamnant les vues de Mitre et rétablissant des dirigeants tels que Juan Manuel de Rosas, entre autres. Cependant, cette nouvelle perspective n’est pas née de l’opposition du bien et du mal.
« J’ai étudié à la Faculté dans les années 1980 et 1990, en chaire et en licence. Ce que j’ai appris à l’université a permis de surmonter ce problème et ce que je regrette, c’est que cela ne transperce pas le bon sens dans l’agenda public. Et par là, je ne parle pas seulement des politiciens, des médias, mais du bon sens partagé qui a une vision et qui me semble inévitable et acceptable. Il est vrai que le monde académique a logiquement ses dynamiques internes, très internes et très peu connectées avec l’extérieur. Oui, quelque chose peut être fait en matière de diffusion pour relier cela au monde universitaire. Mettre une nouvelle vision de l’histoire à la portée des gens qui n’ont pas besoin de savoir ce qu’ont écrit Tulio Halperín Donghi, Hilda Sábato, José Carlos Chiaramonte, Marcela Ternavasio”, a expliqué Sacheri et il a ajouté : “C’est pourquoi j’ai commencé à penser que j’avais un public créé à partir du monde de la fiction et cela me donne une certaine visibilité qui serait bien pour diffuser cette histoire.
Dis-le comme un professeur
En entrant dans « Les jours de violence », le lecteur remarque que le ton choisi par Sacheri est celui du professeur donnant un cours d’histoire, avec des métaphores, avec des explications, avec un récit supportable que beaucoup auraient aimé avoir pendant son séjour à l’école. .
«J’enseigne toujours au lycée. J’ai quitté l’université il y a longtemps. J’ai réduit les heures que je donnais et je me suis retrouvé avec quelques heures dans une école secondaire le lundi matin. Je le fais parce que c’est une partie de ma vie que j’apprécie. Je me reconnais également comme professeur d’histoire et je ne cesserai jamais de l’être. Il me semble que c’est un travail utile pour les autres, même si tous les métiers ont leur utilité, et que cela donne un plus. J’ai étudié l’histoire parce que je trouvais utile de partager avec les autres. Et j’ai découvert que ça me plaisait», a avoué Sacheri, qui apprécie son travail d’enseignant car il l’a aussi aidé à trouver le ton pour écrire des livres d’histoire.
“Pour ces livres, j’ai fini par découvrir que l’oralité de la classe est le seul ton possible pour les écrire.”
Le tremplin vers la divulgation
«Maintenant, j’écris le troisième. C’est pour cela que je lis ce qui a été écrit au cours des dix dernières années, car cela fait dix ans que j’ai quitté la Faculté. Je fais l’heureux “état des lieux”. Mais quand je commencerai à écrire, je sais que je vais retrouver le même désordre. Lorsque vous écrivez un roman, lorsque vous affinez le ton que vous souhaitez donner à ce roman, vous le maintenez », explique l’auteur.
Sacheri a avoué qu’il se sent plus à l’aise pour écrire des romans que pour écrire de l’histoire, car dans le second cas, la question est plus complexe.
« Quant aux livres d’histoire, ce n’est pas facile, car on commence à écrire et, bien sûr, on est confronté à des problèmes complexes. Alors vous devenez complexe et écrivez un article, mais vous réalisez que personne ne le comprendra, personne ne l’appréciera. L’idée est qu’il doit y avoir du plaisir pour le grand public », prévient le professeur lorsqu’il souligne qu’il se sent dans une situation charnière où le texte de diffusion de l’histoire doit être divertissant mais sérieux, et avec le contenu le plus actuel. information. Elle est discutée dans le domaine académique en même temps.
« C’est pour ça que je me dis que ça doit être divertissant, amusant et je pense que je deviens un imbécile. Quelqu’un du monde universitaire le prend et dit que c’est absurde. Ainsi, l’oralité de la classe finit par être la plus correcte car à l’école vous mettez des sujets à disposition des élèves et vous les accompagnez dans leur complexité. Je le fais de manière pendulaire parce que je te prends mais quand je sens que tu te perds je ralentis un peu, et puis je reviens.”
« Cela doit être une divulgation. Une étape de communication entre les universitaires et le monde extérieur. Comme une courroie de transmission à la fois agréable à lire et complexe de connaissance. Je le dis et ça a l’air très joli mais c’est difficile », complète l’auteur.
série d’anachronisme
Ces dernières années sont apparues des séries télévisées ou en streaming qui sont d’époque et cherchent à inclure des personnes de couleur ou à offrir aux femmes des espaces de pouvoir qu’elles n’avaient pas à l’époque. Sacheri a exprimé qu’il s’oppose à cette idée parce qu’elle montre un anachronisme de quelque chose qui ne s’est pas produit et qu’elle efface le changement, elle balaye sous le tapis les luttes pour avoir un monde où le racisme n’existe pas et où les femmes jouissent des droits comme les hommes.
« Les audiovisuels abordent mal le passé car ils proposent une vision anachronique du passé. Cela me rend fou », a avoué Sacheri.
« Il y a un malaise à accepter que le passé était différent du présent et cela me semble extrêmement dangereux comme symptôme de cette époque. Nous n’avons pas besoin de réécrire le passé, nous devons le comprendre. Ce qu’il faut écrire, c’est l’avenir, avec ce que nous décidons de faire de l’humanité. De plus, cette réécriture du passé efface la notion de changement essentielle à l’histoire. Et cela efface ce que les êtres humains ont travaillé dur pour changer. S’il s’avère maintenant que la noblesse anglaise du XVIIIe siècle est peuplée de noirs et peuplée de femmes occupant des rôles très importants dans tous les domaines, nous effaçons le fait qu’elle était une société absolument sexiste et raciste. Si ce n’est pas le cas aujourd’hui, célébrons le fait que nous avons une société plus diversifiée et horizontale et acceptons que les sociétés ont changé parce que les gens ont décidé qu’elles devaient changer. Parce que cela va continuer à changer », Sacheri a attaqué cette vision anachronique de l’histoire.
« Cette chose mythique selon laquelle nous vivons dans une société définitive est une notion très totalitaire. Tout totalitarisme repose sur le sentiment que la fin d’un chemin est ressentie comme la perfection de quelque chose. Et ce n’est pas juste et j’utilise volontairement le concept totalitaire même s’il semble fort. Mais si l’on se considère comme la fin d’un processus de changement, le sommet qu’une société peut atteindre. Cela n’arrive pas et cela n’arrivera pas. Les choses vont continuer à changer et nous devons faire attention où nous voulons aller. Si je dis que le passé n’a pas changé et que l’avenir non plus, j’enlève aux gens les outils émotionnels et rationnels nécessaires pour apporter des changements ou pour être capables de voir des directions. L’étude de l’histoire implique des comparaisons, tout comme les autres études sociales. Déformer le passé pour réduire les tensions comparatives est pour moi une mauvaise idée », a conclu Sacheri.
Détails du livre
Nom: Les jours de violence. Une histoire de l’Argentine à l’époque où elle commençait à être l’Argentine (1820 – 1852)
Auteur: Eduardo Sacheri
Éditorial: Alfaguara





